La stratégie, ontologiquement reliée à la politique, est un art consistant à créer de la puissance. A ce titre, le stratégiste peut chercher à discipliner sa réflexion (c’est l’objet de la théorie stratégique), mais il sera toujours impossible d’en faire une science au sens positiviste du terme. En revanche, il existe une science militaire qui consiste à utiliser des modèles mathématiques pour modéliser un certain nombre de phénomènes. L’ouvrage de Michael E. O’Hanlon, chercheur à la Brookings Institution, se veut ainsi unmanuel présentant aux non-spécialistes les bases de cette science militaire.
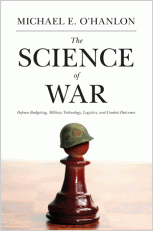 L’ouvrage se divise en quatre grande parties, traitant successivement des budgets de défense, de la modélisation des forces et des résultats des engagements, de la logistique et enfin des questions techniques. Ainsi, le premier chapitre présente plusieurs manières d’évaluer le budget des forces armées, soit en le distinguant par armée, soit par fonction, soit par compétence géographique. O’Hanlon montre qu’en fonction de la méthodologie employée, des redondances ou des incohérences apparaissent et qu’utiliser plusieurs modes de calculs est un moyen efficace de faire des arbitrages budgétaires. Même chose pour la modélisation des forces. O’Hanlon présente brièvement quelques-une des méthodologies employées pour prédire les résultats des engagements, en commençant par les fameuses équations de Lanchester (célèbres pour le fait que des dizaines d’années d’expérimentations ayant démontré qu’elles ne permettaient pas de reproduire convenablement des engagements passés et encore moins de prédire ceux futurs ne suffisaient pas à diminuer leur popularité), en montrant fort heureusement les limites. D’autres modèles de recherche opérationnelle sont ainsi évoqués, en particulier les modèles Kugler-Posen et Epstein. A chaque fois, O’Hanlon applique ces modèles à des engagements réels, montrant leur utilité prédictive et leurs limites. Cette partie est intéressante, mais un peu courte: on aurait aimé plus de détails sur chacun de ces modèles. De même, on est surpris de l’absence de présentation du modèle TACWAR utilisé par le Pentagone. Certes, l’intégralité des milliers de variables prises en compte dans ce modèle est classifiée, mais l’auteur aurait au mois pu évoquer son existence, et éventuellement sa valeur comparée aux modèles civils et ouverts qu’il présente. Le reste du chapitre est consacré à la modélisation des forces pour un assaut amphibie et aux modèles utilisés pour évaluer les opérations de contre-insurrection. Ici, le livre de O’Hanlon souffre de son âge (il a été publié en 2010), puisque la RAND corporation (entre autres) a depuis publié plusieurs études sur ces sujets présentant des modèles plus sophistiqués et plus précis que ceux présentés dans l’ouvrage.
L’ouvrage se divise en quatre grande parties, traitant successivement des budgets de défense, de la modélisation des forces et des résultats des engagements, de la logistique et enfin des questions techniques. Ainsi, le premier chapitre présente plusieurs manières d’évaluer le budget des forces armées, soit en le distinguant par armée, soit par fonction, soit par compétence géographique. O’Hanlon montre qu’en fonction de la méthodologie employée, des redondances ou des incohérences apparaissent et qu’utiliser plusieurs modes de calculs est un moyen efficace de faire des arbitrages budgétaires. Même chose pour la modélisation des forces. O’Hanlon présente brièvement quelques-une des méthodologies employées pour prédire les résultats des engagements, en commençant par les fameuses équations de Lanchester (célèbres pour le fait que des dizaines d’années d’expérimentations ayant démontré qu’elles ne permettaient pas de reproduire convenablement des engagements passés et encore moins de prédire ceux futurs ne suffisaient pas à diminuer leur popularité), en montrant fort heureusement les limites. D’autres modèles de recherche opérationnelle sont ainsi évoqués, en particulier les modèles Kugler-Posen et Epstein. A chaque fois, O’Hanlon applique ces modèles à des engagements réels, montrant leur utilité prédictive et leurs limites. Cette partie est intéressante, mais un peu courte: on aurait aimé plus de détails sur chacun de ces modèles. De même, on est surpris de l’absence de présentation du modèle TACWAR utilisé par le Pentagone. Certes, l’intégralité des milliers de variables prises en compte dans ce modèle est classifiée, mais l’auteur aurait au mois pu évoquer son existence, et éventuellement sa valeur comparée aux modèles civils et ouverts qu’il présente. Le reste du chapitre est consacré à la modélisation des forces pour un assaut amphibie et aux modèles utilisés pour évaluer les opérations de contre-insurrection. Ici, le livre de O’Hanlon souffre de son âge (il a été publié en 2010), puisque la RAND corporation (entre autres) a depuis publié plusieurs études sur ces sujets présentant des modèles plus sophistiqués et plus précis que ceux présentés dans l’ouvrage.
Si les deux premiers chapitres sont un peu courts, mais globalement intéressants, on est particulièrement surpris par les deux derniers. Le chapitre sur la logistique est une succession de platitudes montrant la difficulté d’acheminer d’un point A à un point B un ensemble de troupes, leur soutien et leur matériel. L’auteur prend plusieurs exemples, mais on ne voit pas bien l’intérêt méthodologique du chapitre qui se contente de relever la difficulté et l’importance de la logistique, sans présenter aucune méthode particulière d’analyse ou de résolution du problème. De même, le dernier chapitre est une compilation incohérente des principaux outils technologiques nécessaires à la guerre moderne (senseurs, communications, propulsion, munitions et protections), suivi d’une présentation des principes de base de la physique permettant de comprendre l’importance et les enjeux des orbites satellitaires et des trajectoires des missiles balistiques, pour se conclure sur une présentation encore plus succincte du B.A-BA de la physique nucléaire. Si on voit en principe l’intérêt dans ce qui se veut un manuel de présenter des compétences techniques de base (qui sont absolument nécessaires, c’est un fait indiscutable), on est franchement réticent face à la formule retenue qui semble beaucoup trop légère.
En fait, cet ouvrage souffre de son positionnement. A vouloir à toute force être une introduction aux questions abordées, il est trop large et trop peu précis. De plus, il fait l’erreur fatale de confondre la science militaire (qui est éventuellement l’objet des deuxièmes et troisième chapitres se focalisant sur les modélisations des forces et la logistique) et les questions scientifiques appliquées aux domaines militaires (sciences économiques pour le premier chapitre et sciences physiques pour le quatrième). En fait, il aurait quasiment fallu consacrer un ouvrage à chaque chapitre: il aurait été autrement plus intéressant de disposer d’un vrai manuel de présentation des modélisations du combat, ou d’une véritable étude serrée des manières d’analyser les budgets de défense. A la place, on a droit à quelques présentations introductives plutôt frustrantes, qui risquent de donner au lecteur curieux mais non-spécialiste l’impression qu’il maîtrise le sujet.
De plus l’ouvrage est pris entre deux feux: ce n’est pas un manuel d’initiation à la tactique ou à l’emploi de la force militaire (voir ici et ici), et ce n’est pas non plus un ouvrage de stratégie. On a donc droit à des développements un peu étranges. En effet, à la fin de chaque chapitre, O’Hanlon donne un certain nombre d’exemples d’application des modèles qu’il présente, par exemple les forces nécessaires à la Chine pour une invasion de Taïwan. Il se livre alors à un scénario, mais qui requiert du lecteur à la fois une connaissance des forces en présence et de l’utilisation des équipements militaires (ce que le livre ne fournit pas), tout en étant complètement décorrélé de réflexions politiques plus générales, et donc de la stratégie. O’Hanlon tombe donc dans le piège technicien de considérer des scénarii en dehors de leur contexte politique, mais ne fournit pas non plus à ses lecteurs les clefs de compréhension militaires permettant de mettre des forces sur les équations abstraites qu’il présente. En soit, ce dernier point n’est pas trop gênant pour les connaisseurs des forces armées, mais dans ce cas-là, l’ouvrage manque sa cible qui était une introduction pour les non-spécialistes.
Au final, l’ouvrage est étrange, assez bizarrement construit et souffre principalement de son positionnement: ni manuel d’analyse militaire ni ouvrage de stratégie, il confond allégrement science militaire et aspects scientifiques des questions militaires. Il n’est donc malheureusement pas le manuel de science militaire qui fait défaut sur le marché.
Olivier Schmitt (Center for War Studies)