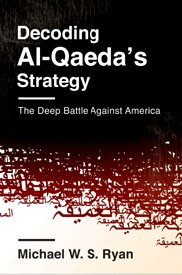L’ouvrage de Michael W. S. Ryan, auteur combinant un doctorat en études islamiques d’Harvard avec 30 ans d’expérience dans le contre-terrorisme aux Etats-Unis, est une contribution très utile à notre compréhension du phénomène djihadiste, mais aussi à l’histoire de la pensée stratégique.
Plutôt que de traiter le djihadisme sous l’angle sociologique (comme de multiples études le font déjà) ou comme une pathologie de détraqués, Ryan prend les auteurs au sérieux et se livre à une exégèse de ce que Thomas Hegghammer a appelé les « études stratégiques djihadistes », c’est à dire le corpus de textes visant à établir une doctrine pour Al Qaïda afin que l’organisation accomplisse son objectif stratégique: la destruction de l’Occident et l’établissement du califat. Ryan montre ainsi l’attention que portent les auteurs qu’il étudie à la qualité de leur argumentation, qui correspond par bien des aspects à des pratiques scientifiques: utilisation de références et de notes de bas de page (avec une connaissance fouillée des écrits stratégiques occidentaux sur la « guerre de quatrième génération » ou de Mao sur la guérilla), combinaison théorie/empirie, évaluation du manuscrit par des pairs avant leur diffusion, etc. Il y a ainsi une véritable recherche de la qualité dans la production stratégique des leaders djihadistes, qui doit donc être prise au sérieux.
Comme bien des livres traitant de ce sujet, Ryan commence par une discussion des écrits de Sayyid Qutb et d’Ayman Al-Zawahiri, mais le cœur de son ouvrage est constitué d’une exégèse de quatre auteurs fondamentaux dans l’univers d’Al Qaïda: Abu Ubayd al-Qurashi, Abd al-Aziz al-Muqrin, Abu Bakr al-Naji, and Abu Musab al-Suri. Al-Qurashi et Al-Muqrin apparaissent à l’analyse comme des passeurs plus que des penseurs: le premier se base sur les écrits militaires occidentaux liés à la contre-insurrection pour montrer l’inévitable victoire finale des djihadistes, tandis que le second cherche principalement à importer les concepts maoïstes de guérilla au sein d’Al-Qaïda. Al-Suri, en revanche, est d’un tout autre calibre. Constatant l’échec à la fois des organisations clandestines et des djihads ouverts (comme en Afghanistan), Al-Suri propose de se retrancher dans le « djihad intérieur », et des tactiques consistant à infliger une série de petites coupures à l’ennemi occidental, qui finira par s’effondrer. En ce sens, il est proche des réflexions de la « résistance sans leader » qui ont alimenté l’extrême-droite américaine dans les années 1950-1960. Il semble improbable qu’Al-Suri ait été exposé à ces idées, il s’agit donc d’un cas intéressant de développement parallèle de concepts similaires. Le problème reste évidemment de transformer la virtuosité tactique des actions individuelles en succès stratégique, un point sur lequel Al-Suri reste assez silencieux. Enfin, al-Naji est le seul de ces auteurs à aborder de front le problème stratégique qui se pose à Al-Qaïda: comment bâtir un califat mondial tant qu’existent les Etats-Unis, dont la puissance médiatique englobe le monde (musulman comme non-musulman) dans un « halo de mensonge »? Sa réponse est de forcer les Etats-Unis à s’engager dans des opérations sanglantes, qui forceront le halo à se déchirer et montreront au monde que le roi est nu, sa puissance vacillante, et la victoire à portée de main. Al-Naji écrit néanmoins dans des termes très généraux, et tend à essentialiser tous les musulmans comme unis dans le même but. La force de l’ouvrage de Ryan est ainsi de montrer les lignes de forces argumentatives, les convergences et dissensions entre les textes et les qualités, mais aussi les faiblesses des doctrines de ces auteurs (dont eux-mêmes sont souvent conscients) en les prenant au sérieux, sans jamais les mépriser.
Deux thèmes reviennent systématiquement dans l’ouvrage. Le premier est que la littérature stratégique d’Al-Qaïda est en fait d’inspiration maoïste, et a peu (ou rien) à voir avec l’Islam, un problème dont ces théoriciens sont conscients, ce qui explique leurs tentatives de tordre les textes religieux autant que possible pour se justifier. Le deuxième est que si les Etats-Unis ont été efficaces pour conduire la « bataille immédiate » (arrêter et tuer les membres d’AQ), ils doivent également s’engager dans la « bataille dans la profondeur » des idées, par exemple en montrant les manquements à la foi et les contradictions des membres d’Al Qaïda. Ces remarques sont malheureusement limitées à la conclusion et mériteraient un plus long développement.
Deux déceptions néanmoins. En premier lieu, presque tous les auteurs mentionnés dans l’ouvrage étaient sortis du jeu en 2005, arrêtés ou tués. Il aurait été utile de savoir si des figures du même acabit intellectuel ont émergé ensuite, et si non, pourquoi. L’analyse reste néanmoins pertinente pour Al-Suri, qui après avoir été capturé par la CIA et remis à la Syrie, aurait été volontairement relâché par le régime de Bachar Al-Assad en 2011 et resterait introuvable depuis. La nouvelle de cette libération a cependant été démentie par Al-Qaïda elle-même. Ensuite, l’exégèse de Ryan est utile, mais se limiter à l’analyse des doctrines comporte un aspect frustrant car cela ne montre pas la manière dont ces doctrines sont réellement mises en œuvres ou non. L’ouvrage ne nous dit rien de la manière dont Al-Qaïda fonctionne, de la circulation de ces textes parmi les milieux djihadistes, de leur appropriation par l’encadrement et les militants. De ce fait, le livre ne permet pas d’expliquer pourquoi des franchises AQ se comportent différemment de ce que la doctrine établie par ces penseurs préconise, comme en Irak. Il est très probable que des considérations politiques locales aient eu plus d’importance que le respect de la doctrine, mais dans ce cas-là, quel est le véritable poids de celle-ci au sein de l’organisation terroriste? Bref, en déconnectant les idées de la pratique, l’auteur ouvre toute une série des questions qui ne trouvent pas leur réponse dans ce livre.
Il s’agit néanmoins d’un ouvrage véritablement utile, qui complète d’autres ouvrages existants en montrant la manière dont les dirigeants d’Al-Qaïda ont conceptualisé leur stratégie à partir de sources intellectuelles très diverses, et qui intéressera à la fois les spécialistes du djihadisme et les lecteurs intéressés par la théorie stratégique.
Olivier Schmitt (Center for War Studies)